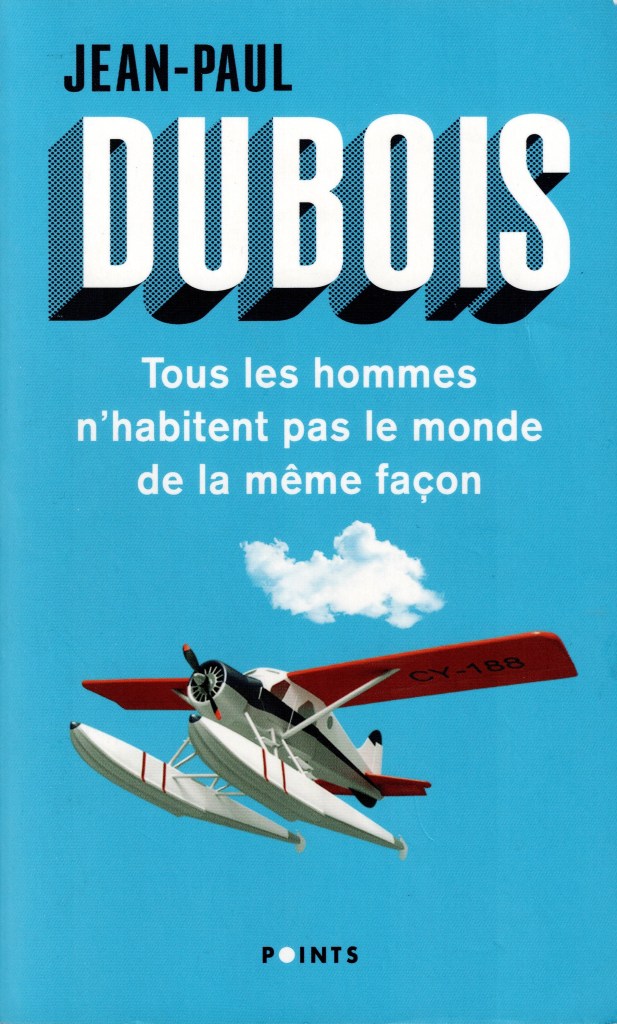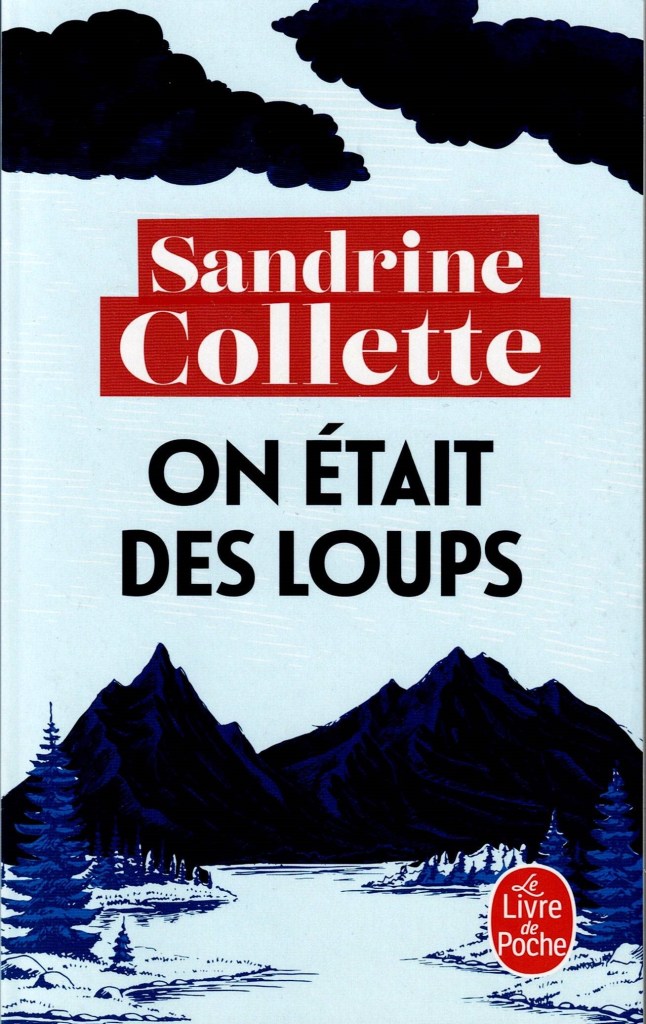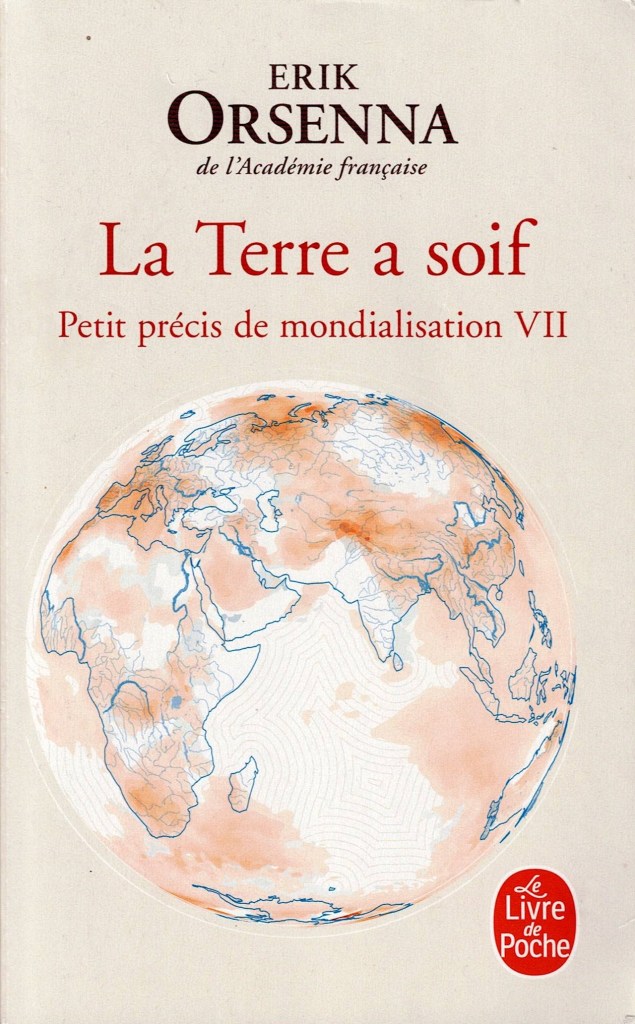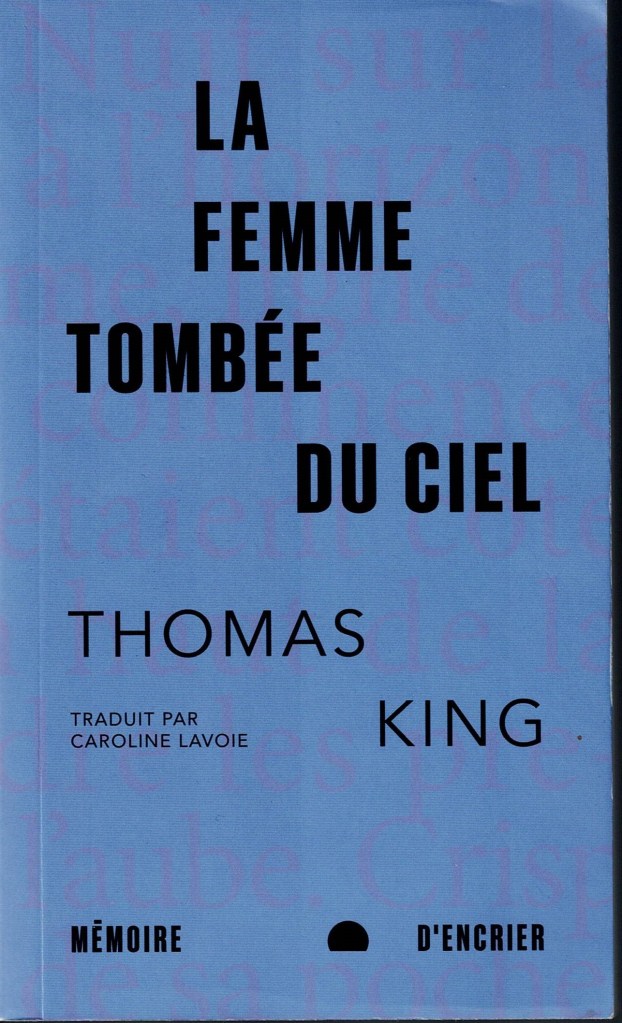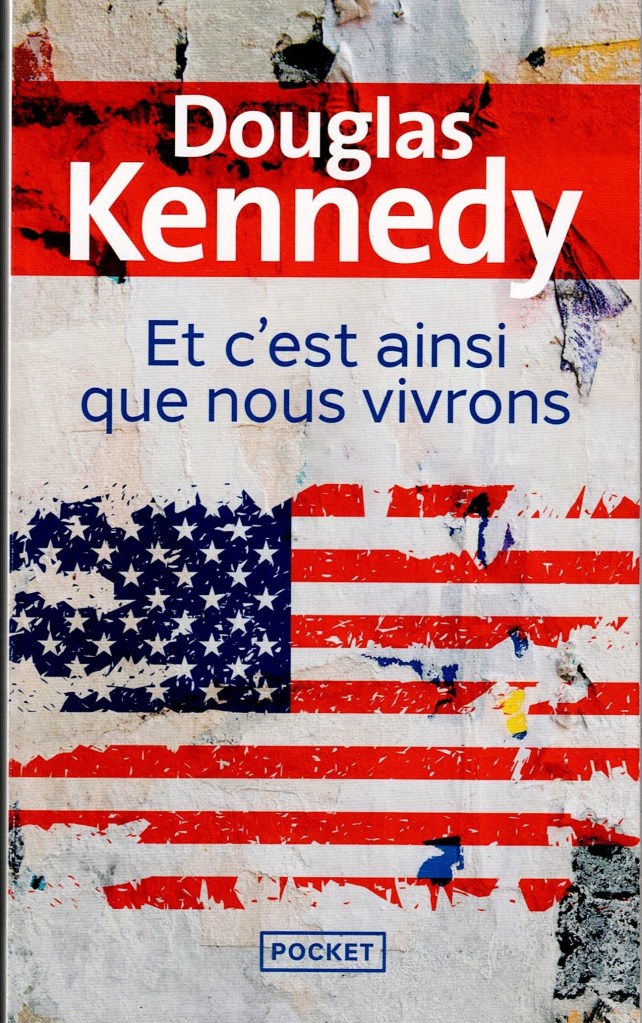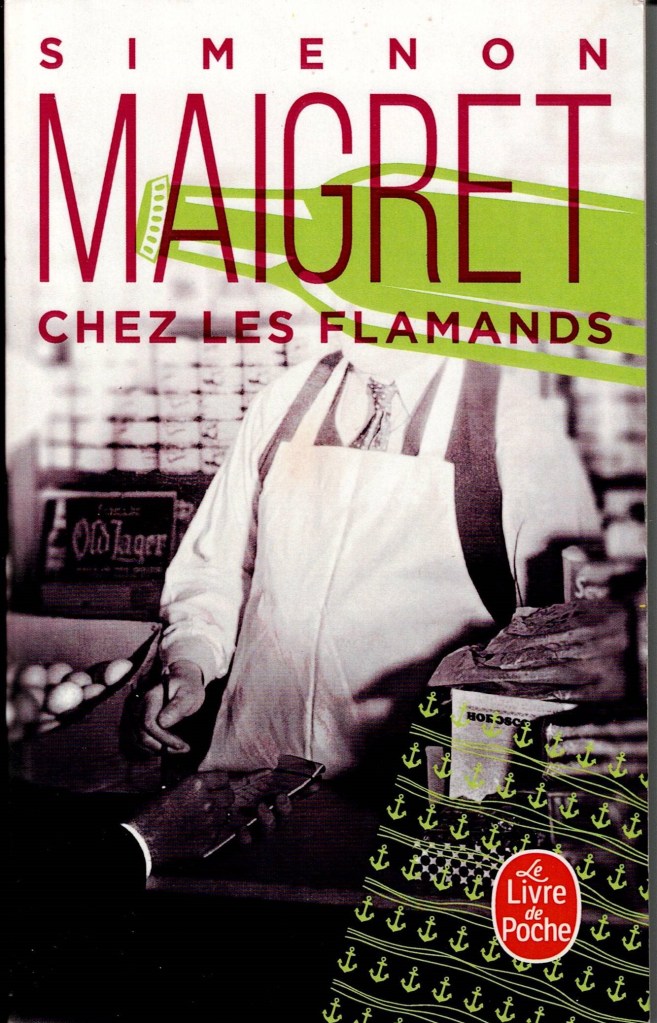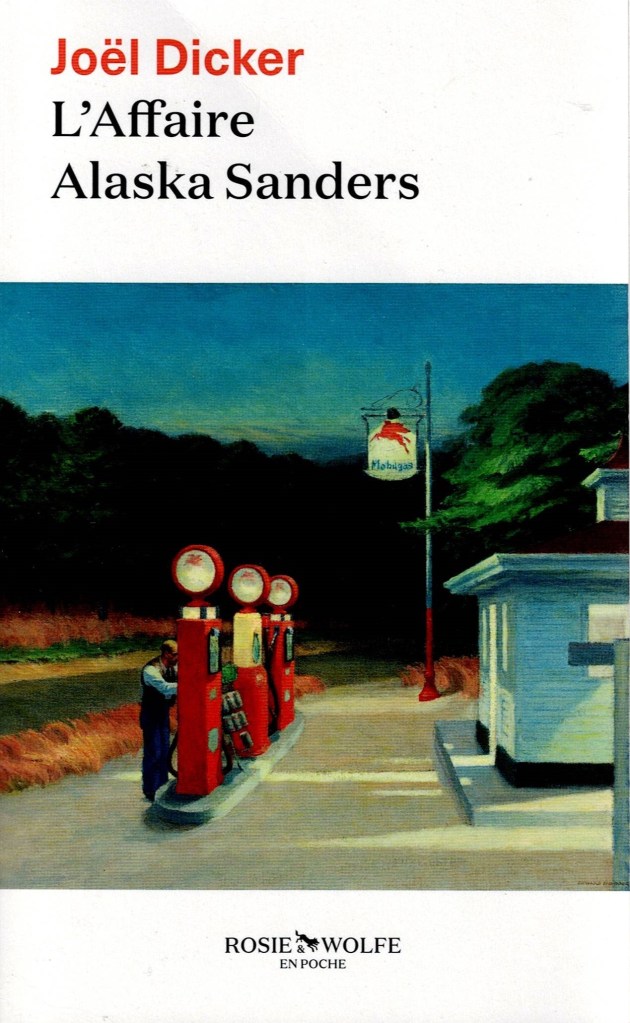Il est rare que je ne lise pas quelques pages d’un roman, d’un essai ou d’un livre scientifique avant de sombrer dans les bras de Morphée. Je vais passer en revue les bouquins qui ont retenu mon attention cette année et qui ont permis de m’évader et de réfléchir sur l’état du monde et des hommes.
« La lecture d’un roman jette sur la vie une lumière », a écrit le poète Louis Aragon.
On était des loups (Sandrine Collette, Le Livre de Poche, 2022)
« On était des loups » est le dernier livre que j’ai lu cette année. Et c’est aussi un des mes gros coups de coeur alors que je l’ai choisi un peu au hasard en flânant dans une librairie. Le roman de Sandrine Collette est une belle histoire entre un père, un homme des forêts, plutôt bourru, qui vit de la chasse et son fils de cinq ans. Liam a toujours préféré se tenir à distance d’Aru pour ne pas renoncer à sa vie au grand air, mais un drame va les réunir.
La lecture est un peu dérangeante au début en raison d’une ponctuation déconcertante, mais on comprend rapidement que c’est pour rendre le récit plus haletant et rentrer dans la tête du narrateur. Liam n’est pas homme à s’embarrasser de virgules. Une fois dans la caboche du père, on ne lâche plus le roman. « On était des loups » séduira les amoureux des grands espaces, des montagnes et des lacs.
« Dans ma tête tout est incohérent, je pense que c’est parce que je ne l’aime pas ce gosse et pourtant je ne lui veux pas de mal seulement s’il me cherche c’est sûr qu’il va me trouver (…) »
Le roman de Sandrine Collette a reçu le prix Jean-Giono 2022, un autre grand conteur du terroir, et le prix Renaudot des Lycéens 2022.
Le complot contre l’Amérique (Philip Roth, Folio, 2004)
J’ai acheté « Le complot contre l’Amérique » après avoir lu un commentaire dans la presse qui pointait les similitudes avec la situation politique actuelle aux Etats-Unis. Puis c’était l’occasion de retrouver Philip Roth, un des plus grands auteurs américains contemporains après avoir dévoré l’an dernier le très beau roman « Un homme ».
« Le complot contre l’Amérique » imagine la victoire du célèbre aviateur Charles Lindbergh, qui était proche des nazis, contre Franklin D. Roosevelt aux élections présidentielles de 1940. Charles Lindbergh prônait le non interventionnisme (ça ne vous rappelle pas quelqu’un ?) dans les conflits qui minaient le monde à l’époque.
Le roman de Philip Roth est à la fois un livre politique et un livre éminemment personnel, écrit à la hauteur d’une famille juive qui croit au rêve américain, mais qui voit monter l’antisémitisme avec une inquiétude croissante au fil des pages. Le narrateur n’est autre que Philip Roth lui-même, âgé de 7 ans à l’époque où il place son récit. Il met en scène sa propre famille avec ses joies, ses doutes, ses peurs et ses déchirures.
« La peur était partout, elle se lisait partout, dans le regard de nos protecteurs surtout, cette expression que l’on prend à l’instant même où l’on aperçoit qu’on vient de fermer une porte dont on n’a pas la clef. »
« Le complot contre l’Amérique » est bien sûr une œuvre de fiction, mais celle-ci a une résonance résolument contemporaine. Dans un post-scriptum, l’auteur retrace les véritables faits historiques, Charles Lindbergh ayant bien eu des sympathies nazies dont les Américains ont pu avoir un aperçu lors de meetings baptisés « America First » (ça ne vous rappelle pas quelqu’un?).
La Terre a soif (Erik Orsenna, Le Livre de Poche, 2022)
« La Terre a soif » n’est ni un roman ni tout à fait un livre scientifique. Erik Orsenna raconte, avec tout son talent d’écrivain, la vie de trente-trois fleuves de notre planète. Il s’agit bien de vie, car les fleuves et les rivières sont les sources de l’humanité, comme le décrit très bien le sociétaire de l’Académie française. C’est le long des cours d’eau que l’homme a fondé ses cités les plus importantes.
Le voyage est à la fois fascinant et inquiétant. Fascinant, car Erik Orsenna emmène le lecteur dans les plus beaux endroits du monde, comme l’Amazonie, le Congo ou encore l’Inde. Mais inquiétant car il démontre que la plupart des fleuves et rivières n’offrent plus assez d’eau pour répondre aux besoins croissants de l’humanité. D’où le titre « La Terre a soif ». Et le sous-titre de la première page de garde: « Guerres et paix aux royaumes des fleuves ».
« Décidément, l’eau, je veux dire la vie, pousse à l’intelligence. »
Erik Orsenna émaille ses reportages de rencontres avec les plus grands spécialistes de l’eau, dont il partage les écrits et les inquiétudes. Si l’homme ne prend pas conscience de son capital « eau », un capital qu’on ne peut pas croître, il court inévitablement à sa perte. Au terme de ce « Petit précis de mondialisation » – le sous-titre de la couverture – une évidence s’impose : l’eau est notre principale richesse. Le livre est aussi source d’espoir, car « La Terre a soif » donne quelques exemples du génie humain, capable, lorsque la volonté politique est présente, d’utiliser l’or bleu en bonne intelligence avec la nature.
La femme tombée du ciel (Thomas King, Mémoire d’encrier, 2022)
J’ai découvert et acheté « La femme tombée du ciel » dans la boutique du très beau musée McCord Steward consacré aux peuples autochtones lors de notre dernière visite à Montréal. De descendance cherokee, l’auteur est un ardent défenseur des premières nations. « La femme tombée du ciel » (« The back of the turtle », en anglais) raconte l’histoire de Gabriel Quinn, un chimiste rongé par les remords et la culpabilité pour avoir mis au point un défolient qui a éliminé toute forme de vie dans une région côtière de la Colombie britannique, d’où il est lui-même originaire.
Le scientifique retourne à l’endroit qu’il a dévasté avec l’intention de mettre fin à ses jours, mais des rencontres étonnantes, dont celle d’une artiste indienne, vont lui redonner doucement goût à la vie. En parallèle, on suit le parcours de Dorian Asher, le patron de Dominion, la société qui a produit et mis en vente le produit mortel.
« Tout ce qu’il voulait, c’était du soleil, et ne surtout pas mourir à l’ombre. Comme il avait vécu. Etait-ce trop demander? »
« La femme tombée du ciel » est une jolie fable écologique racontée avec beaucoup de poésie, mais aussi une pincée de cruauté. Le roman dénonce la course au rendement de l’industrie chimique avec ses conséquences dévastatrices sur l’environnement. Les personnages, même celui, pourtant controversé, du PDG de Dominion, révèlent tous leur part d’humanité.
Et si l’homme vivait au rythme des tortues?
Et c’est ainsi que nous vivrons (Douglas Kennedy, Pocket, 2022)
Intéressé par les élections américaines, j’ai été intrigué, en flânant dans une librairie tournaisienne, par la couverture d’un livre avec le drapeau étoilé déchiré. « Et c’est ainsi que nous vivrons » envoie le lecteur en 2045. L’Amérique est divisée en deux : d’un côté, la République, très progressiste, mais sous l’emprise de la techno-surveillance et de l’autre, une Confédération transformée en théocratie où le blasphème et l’avortement peuvent valoir la peine de mort. C’est soit Big Brother, soit l’inquisition pour reprendre les mots d’une journaliste du magazine Elle.
Douglas Kennedy a voulu écrire un roman d’anticipation. On pense inévitablement aux divisions de l’Amérique actuelle en suivant les péripéties de l’agent Samantha Stengel chargée de s’infiltrer dans la Confédération pour assassiner sa propre sœur. « Et c’est ainsi que nous vivrons » est une réflexion sur deux mondes qui sont immondes chacun à leur façon. C’est aussi un roman psychologique, car le lecteur entre dans la tête de l’agent Stengel avec ses doutes, ses angoisses et ses espoirs.
« Toutes les révolutions ont leur acteur principal: l’idéologue, la figure de proue, la pasionaria capable de vinifier les vins de la colère. Dans le meilleur des cas, c’est un Washington, un Lincoln, un Martin Luther King. Et dans le pire, c’est un Robespierre, un Mao ou un Staline. Ici, on a eu droit à un multimilliardaire de la tech: Morgan Chadwick (…) »
J’aurais voulu que Douglas Kennedy s’attarde un peu plus sur les raisons qui ont conduit à la sécession de l’Amérique, mais on se laisse prendre par l’exploration de ces deux mondes qui, on l’espère vivement, ne verront jamais le jour.
Maigret chez les Flamands (Georges Simenon, Le Livre de Poche, 1932)
C’est toujours un plaisir de retrouver Maigret. Georges Simenon n’a pas son pareil pour créer une atmosphère et sonder la psychologie de ses personnages, le tout dans une écriture simple, sans fioritures.
Le commissaire Jules Maigret a déposé ses valises à la frontière franco-belge, à Givet, pour mener une enquête à titre privé à la demande d’Anna Peeters, la fille de commerçants flamands aisés, dont la boutique est installée le long de la Meuse.
« Comme d’habitude, Maigret était debout dès huit heures du matin. Les mains dans les poches du pardessus, la pipe aux dents, il resta un bon moment immobile en face du pont, tantôt regardant le fleuve en folie, tantôt laissant errer son regard sur les passants »
La famille Peeters – « Les Flamands », comme les gens du coin la surnomment – est soupçonnée d’avoir fait disparaître Germaine Piedbœuf, la fille d’un veilleur de nuit, dont Joseph Peeters, le fils plein d’avenir, a eu un enfant.
Georges Simenon, d’origine liégeoise, retrouve le fleuve de sa jeunesse, la Meuse, qui est un personnage à part entière dans « Maigret chez les Flamands ». La fin est surprenante, le commissaire pouvant faire preuve d’indulgence. Un classique, mais qui est indémodable.
L’affaire Alaska Sanders (Joël Dicker, Rose & Wolfe en poche, 2022)
Joël Dicker est l’auteur de polars à la mode. « La vérité sur l’affaire Harry Quebert » est son roman le plus connu qui a fait l’objet d’une série télévisée qui a été diffusée sur TF1. « L’Affaire Alaska Sanders » est la suite, mais on peut le lire sans avoir lu « Harry Quebert ». On retrouve les mêmes personnages principaux à savoir l’écrivain Marcus Goldman et le sergent Perry Gahalowood.
C’est une vieille affaire qui va réunir les deux hommes dont l’amitié est teintée à la fois d’humour et d’ironie douce. Le policier pensait avoir élucidé un crime onze ans plus tôt, en l’occurrence le meurtre d’une jeune femme, Alaska Sanders, mais une lettre anonyme qui va tout d’abord inquiéter son épouse va relancer l’enquête. Cette affaire va trotter à nouveau dans la tête du sergent qui va aussi devoir affronter un drame plus personnel.
« Quand je n’étais pas occupé à ruminer l’affaire Alaska Sanders, je m’occupais de ce qui restait de la famille Gahalowood. Perry était l’ombre de lui-même: déjà d’ordinaire taiseux, il s’était muré dans un mutisme total ».
J’aime beaucoup la manière dont Joël Dicker ausculte ses personnages, particulièrement Marcus Goldman, un écrivain en proie aux doutes tant sur les plans professionnels qu’amoureux. L’intrigue est relativement classique, mais bien ficelée avec, comme il se doit pour ton bon polar, des rebondissements qui donnent envie d’aller jusqu’au bout.
Des lecteurs de Joël Dicker se sont dit déçus par ce récit, mais personnellement, j’ai apprécié ce voyage dans le New Hampshire américain.
Méfie-toi du chien qui dort (Samantha Downing, Haute Ville, 2023)
Encore un livre choisi au hasard, sur la base de la couverture et du quatrième de couverture. Fan des toutous, je ne pouvais qu’être intrigué par cette affaire de dog-sitting qui se déroule dans la banlieue chic de San Francisco. Je n’ai pas été déçu par ce polar qui se lit très rapidement (118 pages).
L’originalité réside dans la narration. Le lecteur se retrouve dans la tête de deux narratrices : Shelby, la dog-sitteuse, et Carla Grady, l’inspectrice qui mène l’enquête pour découvrir qui a tué Todd Burke, le propriétaire du chien, Pluto, dont s’occupait Shelby.
« Pluto n’arrête pas d’aboyer. Il sent la mort, comme tous les chiens, et je dois lutter pour l’éloigner du corps. Ce n’est pas simple, ce Husky est un tas de muscles. »
L’intrigue est résolue un peu à la manière d’un puzzle où tous les éléments se mettraient en place sur un simple claquement de doigts. Ce n’est pas pour rien que l’inspectrice fait, à un moment important du roman, allusion au film Usual Suspects.
Bref, c’est admirablement bien mené. Je conseille le livre à un jeune qui débute dans la lecture de polars.